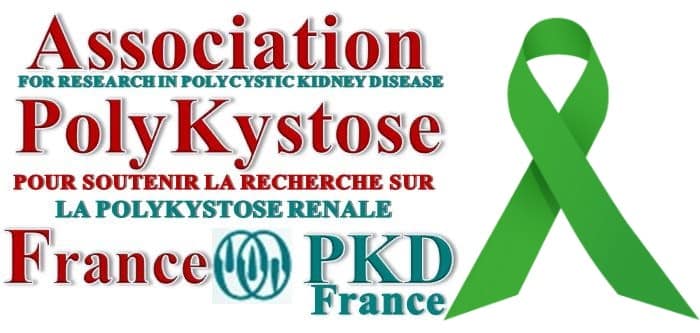Polykystose rénale-Polycystic kidneys
Objectif terminal : Diagnostiquer une polykystose rénale
Auteur : Dr Stephane Burtey
La découverte de multiples kystes dans le parenchyme rénal est devenue fréquente depuis l’avènement de techniques d’imagerie performantes et simples d’accès. Le terme de polykystose rénale doit être réservée à deux maladies génétiques: la polykystose rénale autosomique dominante (PKD) et la polykystose rénale autosomique récessive (PKR). Le diagnostic d’une maladie génétique est un diagnostic grave, il engage l’individu et toute sa famille. Le diagnostic doit être certain. La PKD s’accompagne de manifestations extra-rénales graves. Il ne faut pas méconnaître ce diagnostic.
1 Définitions
1.1 Un kyste rénal
Un kyste rénal est une cavité remplie de liquide, limitée par une couche de cellules épithéliales, dont l’origine est une dilatation de n’importe quelle partie du néphron ou du tubule collecteur. La présence de kystes dans les reins est un événement banal. Dans des séries autopsiques, plus de 50% des sujets de 50 ans présentent au moins un kyste rénal microscopique.
1.2 Transmission autosomique dominante
Le mode de transmission autosomique dominant se caractérise par la présence du trait phénotypique si un seul allèle muté est présent. La transmission est verticale, il n’y a pas de saut de génération. Le risque de transmission du trait phénotypique à la descendance est de 50%.
1.3 Transmission autosomique récessive
Le mode de transmission autosomique récessif se caractérise par la présence du trait phénotypique si les deux allèles du gène sont mutés. Chaque parent apporte un allèle muté. Les parents sont indemnes de l’affection. Le risque d’apparition de la maladie dans la fratrie est de 25%. Pour plus d’informations sur les modes de transmission mendélien et la réalisation d’un arbre généalogique nous conseillons la consultation du site Orphaschool (http://www.orpha.net/orphaschool/elearn1.htm)
2 Les maladies kystiques rénales (MKR)
L’origine des kystes rénaux peut être acquise, congénitale ou génétique.
2.1 Les kystes acquis du rein
La présence de kystes dans les reins est un événement fréquent chez l’homme.
2.1.1 Les kystes simples du rein
Il s’agit de kystes solitaires ou multiples. Ils sont de localisation corticale ou médullaire Ils sont fréquents dans la population générale. Ils sont exceptionnels chez l’enfant et rares avant 30 ans. Après 50 ans ils deviennent fréquents. Leur fréquence augmente avec l’âge, ainsi plus de 25% des hommes âgés de 75 ans présentent au moins un kyste rénal en échographie et dans 10% des cas ils sont bilatéraux. Leur physiopathologie est inconnue.
2.1.2 La multikystose acquise du dialysé et de l’insuffisance rénale chronique
L’insuffisance rénale chronique (IRC) s’accompagne fréquemment de l’apparition de multiples kystes rénaux. Il ne faut pas confondre cette complication de l’IRC avec une maladie génétique rénale et en particulier la PKD. La présence de ces multiples kystes rénaux ne s’accompagne pas d’une augmentation du volume rénal, qui est constante quand la polykystose rénale autosomique dominante se complique d’insuffisance rénale. Sa fréquence est de 90% après 10 ans d’hémodialyse. C’est un état pré-cancéreux. Sa physiopathologie est inconnue.
2.2 Les kystes congénitaux
2.3 Les maladies kystiques rénales génétiques
Il existe de nombreuses maladies rénales kystiques génétiques. Elles sont classées en fonction de leur mode de transmission. La plus fréquente est la polykystose rénale autosomique dominante. Le diagnostic différentiel repose sur l’analyse du mode de transmission (arbre généalogique), le volume rénal et les tumeurs associées (échographie et scanner rénal) et les manifestations cliniques associées (atteinte hépatique, cutanée et syndrome dysmorphique). Toutes les MKRG sont des ciliopathies. Il s’agit de maladies du cil primaire.
3 La polykystose rénale autosomique dominante
La polykystose rénale autosomique dominante est une maladie génétique fréquente de l’adulte. Elle se caractérise par la présence de nombreux kystes rénaux et un mode de transmission autosomique dominant.
3.1 Épidémiologie et génétique
3.1.1 Épidémiologie
C’est la maladie génétique rénale la plus fréquente. Elle touche 1 personne sur 800 dans la population générale. Elle est responsable de 8% des cas d’insuffisance rénale chronique terminale en France.
3.1.2 Génétique
C’est une affection de transmission autosomique dominante. Deux gènes peuvent être mutés dans la PKD. Dans 85% des cas il s’agit de PKD1 et dans 15% des cas de PKD2. PKD1 est localisé en 16p13, c’est un gène de 52 Kb comportant 46 exons transcrits en un ARNm de 14 kb qui est traduit en une protéine membranaire de 4302 amino acides la polycystine-1 (PC-1). Sa fonction précise est inconnue. PKD2 est localisé en 4q21, c’est un gène de 68 kb comportant 15 exons transcrit en un ARNm de 5 kb traduit en une protéine membranaire de 968 amino acides, la polycystine-2 (PC-2). La polycystine-2 est un canal calcique de la famille TRP. Il existe une grande variabilité dans l’expression clinique de la PKD. Cette variabilité est génétiquement contrôlée. Les mutations sont privées, il n’y a pas de mutations récurrentes. Les patients mutés dans PKD1 ont un âge moyen de mise en dialyse de 54 ans contre 74 ans pour ceux mutés dans PKD2. Le siège de la mutation dans PKD1 a aussi un impact sur la sévérité de la maladie rénale et extra rénale. Les kystes se développent au dépend de 1 à 2% des néphrons alors que toutes les cellules rénales portent la mutation de PKD1 ou PKD2. Le développement des kystes est secondaire à l’apparition d’un deuxième coup moléculaire (mutation somatique) dans le gène PKD1 ou PKD2. L’apparition des kystes dépend de cet événement. Ce modèle permet de comprendre la variabilité d’expression de la maladie. La fréquence de survenue des kystes dépend de la fréquence des mutations somatiques dans les cellules rénales. La PKD est une maladie autosomique récessive à l’échelon cellulaire. 5 à 10% des patients portent une mutation de novo.
3.2 Manifestations cliniques
La polykystose rénale autosomique dominante est une maladie systémique. Il existe des manifestations secondaires à la présence des kystes ou d’une maladie du tissu élastique et du muscle lisse. Il existe des atteintes rénales et extra-rénales. Les deux complications majeures de la PKD sont le développement de l’insuffisance rénale chronique et les anévrysmes des artères cérébrales. Le diagnostic peut être posé devant une de ces manifestations cliniques, mais de plus en plus lors du dépistage familial.
3.2.1 Les kystes
3.2.1.1 Les kystes rénaux
Ils sont constants. Leur augmentation de volume est lente, progressive et bilatérale. Ils sont responsables de l’ensemble des manifestations rénales de la PKD. La sévérité des symptômes rénaux et de l’insuffisance rénale est corrélée au volume kystique. Il se complique d’une augmentation du volume rénal qui est responsable de douleurs liées à la distension de la capsule. Les douleurs peuvent être le symptôme d’une d’hémorragie intra-kystique (colique néphrétique, d’une migration lithiasique, d’infections (infections de kystes et pyélonéphrite). Les kystes rénaux peuvent responsable d’épisodes d’hématurie macroscopique. L’insuffisance rénale est secondaire à la destruction du parenchyme rénal sain par les kystes. Elle peut survenir à tous les âges. Elle apparaît en général dans la 4ème décennie et 50% des polykystiques sont en traitement de suppléance à 54 ans. Ensuite tous les 10 ans, 10% des patients restant développent une IRCT. Pour PKD2, cette séquence est décalée en général de 20 ans. La vitesse de dégradation du débit de filtration glomérulaire est approximativement de -5 ml/an.
3.2.1.2 Les kystes hépatiques
Ils apparaissent chez 70% des patients, plus tardivement que les kystes rénaux et plus fréquemment chez les femmes. Ils sont le plus souvent asymptomatiques. La principale complication est liée à l’hépatomégalie et à la compression des organes de voisinage. Ils ne se compliquent pas d’insuffisance hépato-cellulaire. La complication la plus redoutable est l’infection.
3.2.1.3 Les autres localisations kystiques
Elles sont rarement symptomatiques. Il existe des kystes pancréatiques chez 30% des patients, des kystes arachnoïdiens chez 10% des patients, tous les organes solides intra-abdominaux peuvent présenter des kystes. Les kystes de l’épididyme peuvent se compliquer de stérilité.
3.2.2 les atteintes non kystiques
3.2.2.1 L’hypertension artérielle
Sa physiopathologie est incomplètement comprise. Elle est secondaire à une stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) par des modifications de la vascularisation rénale liées à la présence les kystes. Elle est précoce et apparaît avant le développement de l’IRC. Elle doit être systématiquement dépistée chez les patients porteurs de PKD ou à risque de PKD et ceci dès l’enfance. Une prise tensionnelle annuelle doit être systématiquement proposé. Il s’agit d’un facteur important de progression de l’insuffisance rénale. Elle doit être prise en charge le plus précocement possible.
3.2.2.2 Les anévrysmes des artères cérébrales
C’est une complication qui touche 10% des polykystiques tout venant et 20% de ceux présentant des antécédents familiaux d’anévrysmes. Ils se compliquent de rupture plus précocement que dans la population générale. La symptomatologie n’est pas différente de celle des anévrysmes de la population générale. Dans les familles à risque un dépistage par angioIRM doit être proposé à partir de l’âge de 20 ans. Si l’angioIRM initiale est négative, un suivi tous les 10 ans semble raisonnable. La prise en charge de ces anévrysmes n’est pas différente de ceux de la population générale. Il existe un risque plus important de dissection des vaisseaux lors des artériographies. La prise en charge de ces anévrysmes doit être multidisciplinaire. La présence d’anévrysme sur d’autres artères de moyen calibre est possible mais moins fréquente.
3.2.2.3 Atteinte cardiaque
La PKD se complique dans 20% des cas d’une valvulopathie (insuffisance mitrale, prolapsus valvulaire mitral, insuffisance aortique). L’apparition d’une hypertrophie ventriculaire gauche est fréquente chez ces patients.
3.2.2.4 Diverticulose digestive
La symptomatologie est sans particularité par rapport à la population générale. Les deux points remarquables sont la précocité d’apparition des diverticules et le développement possible sur tout le tube digestif.
3.2.2.5 Hernie inguinale
3.3 Les facteurs pronostics de la PKD
Les deux facteurs pronostic ayant le plus d’impact sur le développement d’une insuffisance rénale sont le génotype PKD1 vs PKD2 et le volume rénal. Plus les reins sont gros, plus ils augmentent de volume rapidement plus le risque d’insuffisance rénale chronique est important. Les autres facteurs de mauvais pronostic sont le sexe masculin, l’âge au diagnostic clinique, la précocité des épisodes d’hématurie macroscopique, la présence d’une HTA, la présence d’une microalbuminurie ou d’une protéinurie, le tabagisme.
3.4 La prise en charge d’une polykystose rénale autosomique dominante
Il n’existe pas de traitement curatif de la polykystose rénale autosomique dominante. La seule mesure ayant montré son efficacité pour ralentir la progression de l’insuffisance rénale chronique est le contrôle de l’hypertension artérielle. La décennie qui vient verra apparaître des traitements spécifiques qui permettront de ralentir la progression de cette affection. Pour l’instant la mesure la plus importante reste le contrôle de l’hypertension artérielle.
3.4.1 Dépistage HTA
Elle doit être systématiquement recherchée dès le plus jeune âge chez les sujets à risque ou les sujets présentant une PKD. Elle peut apparaître dès l’enfance. La prise tensionnelle se fera à un rythme annuel. Si une HTA est dépistée, l’objectif tensionnel est de 130/80 mm d’Hg. Aucun médicament n’a montré une supériorité en termes de néphroprotection. En cas d’HVG, de microalbuminurie ou d’une protéinurie associée le choix se fera en premier sur un bloqueur du SRAA: inhibiteur de l’enzyme de conversion ou antagoniste des récepteurs de l’angiotensine (Sartans). L’arrêt du tabac est capital pour ralentir la vitesse de progression de l’IRC et limiter le risque cardiovasculaire.
3.4.2 Dépistage AAC
Le dépistage des anévrysmes des AAC sera systématique chez les patients porteurs d’une polykystose dont un des parents à déjà présenté un anévrysme, une hémorragie intracérébrale ou méningée ou un AVC. Il reposera sur la réalisation d’une AngioIRM tous les dix ans. Le contrôle tensionnel et l’arrêt du tabac sont deux points capitaux pour limiter le risque de rupture d’anévrysme.
3.4.3 L’information à la famille
La PKD est une maladie génétique. Il est important d’informer le patient du risque de transmission à sa descendance. Il faut que le patient informe les membres de sa famille de sa maladie génétique et du risque pour eux d’en être atteint. Le risque de transmission à la descendance est de 50%. Un individu non atteint ne transmet pas la maladie à sa descendance. Une échographie rénale ne doit être réalisée qu’en cas de signe clinique ou du désir d’un dépistage. La réalisation d’une échographie rénale doit être faite en informant le patient des résultats possibles.
4 La polykystose rénale autosomique récessive
La PKR est une maladie pédiatrique rare. Sa prévalence est de 1/30000 naissances. C’est une affection grave de transmission autosomique récessive. Le risque de récurrence dans la fratrie est de 25%. Le gène muté est PKHD1 localisé sur le chromosome 6p12. Il code pour une protéine de 4074 aminoacides: la fibrocystine. Sa fonction est inconnue. La PKR se caractérise par une atteinte rénale et hépatique. La sévérité des deux atteintes est variable d’un patient à l’autre. La sévérité de la maladie est variable. La présentation néonatale peu être très sévère avec une hypoplasie pulmonaire conduisant au décès. Avant la première année le diagnostic est souvent fait devant l’atteinte rénale. Durant la période infantile, l’atteinte rénale (gros rein ou HTA) est souvent au devant de la scène. Plus tard, c’est souvent devant l’atteinte hépatique que le diagnostic est porté ou devant la présence d’une HTA. Le diagnostic précoce est de mauvais pronostic rénal et vital.
4.1 Le rein
La lésion rénale de base est une dilatation des tubes collecteurs. Cette dilatation peut ensuite donner naissance à des kystes. Le diagnostic peut être anténatal ou néonatal sur une échographie qui mettra en évidence des gros reins hyperéchogènes. Le volume rénal a ensuite tendance à se normaliser avec l’apparition de kystes rénaux. Il existe quelques cas d’augmentation du volume rénal. L’atteinte rénale se complique d’IRCT dans 20 à 30% des cas. L’HTA et fréquente.
4.2 Le foie
L’atteinte hépatique se caractérise par une fibrose hépatique se compliquant d’une hypertension portale associée à une prolifération des canaux biliaires. Les voies biliaires peuvent être dilatées. On parlera de maladie de Caroli qui prédispose aux cholangites. La complication principale de la fibrose hépatique périportale est le développement d’une hypertension portale qui se compliquera de varices oesophagiennes et d’une splénomégalie majeure.
5 Le diagnostic
Le diagnostic de la polykystose rénale autosomique dominante est un diagnostic fréquent. Il est important de ne pas porter un diagnostic par excès. Le diagnostic d’une maladie génétique implique l’individu mais aussi toute sa famille. Les autres maladies kystiques rénales ont des complications spécifiques qui nécessiteront une prise en charge spécialisée (par exemple, la maladie de Von Hippel Lindau ou la sclérose tubéreuse de bourneville et la fréquence des cancers rénaux associés). Il est indispensable d’avoir un avis spécialisé quand le diagnostic est suspecté.
5.1 Les circonstances du diagnostic
La découverte de kystes rénaux peut se faire dans des circonstances variées. Devant des symptômes: douleur, hématurie, infection urinaire, organomégalie, bilan d’une HTA, bilan d’une insuffisance rénale chronique. Lors d’un examen systématique. Enfin dans la PKD, le diagnostic est souvent fait lors d’un examen de dépistage dans la famille.
5.2 Les informations indispensables
La PKD se caractérise par la présence de kystes rénaux et par le mode de transmission autosomique dominant. Il faut évaluer le nombre de kystes, le volume du parenchyme rénal, l’absence de tumeurs associées et le mode de transmission. La recherche d’une atteinte cutanée, ophtalmologique, d’un syndrome malformatif permettra d’évoquer d’autres maladies plus rares (tableau 2). L’atteinte hépatique permet en général de faire le diagnostic de PKR
5.2.1 La présence de kystes et la taille des reins
L’échographie et le scanner permettront de mettre en évidence deux gros reins déformés par de multiples kystes corticaux et médullaire dans la PKD. Les critères échographiques retenus pour porter le diagnostic de PKD chez un patient apparenté à un patient présentant une PKD sont: Avant 30 ans, présence d’au moins deux kystes rénaux uni ou bilatéraux. Entre 30 et 60 ans, présence d’au moins deux kystes dans chaque rein. Après 60 ans, présence d’au moins 4 kystes dans chaque rein. Après 30 ans, l’absence de kystes dans les reins élimine le diagnostic de PKD. S’il n’y a pas d’histoire familiale, il est indispensable d’évaluer le volume rénal. Chez un insuffisant rénal chronique, des kystes rénaux, sans augmentation du volume rénal, sans histoire familiale élimine quasiment une PKD, il sera retenu le diagnostic de multikystose acquise de l’IRC. Il devra être recherché une autre cause à l’insuffisance rénale. Il est indispensable de rechercher des kystes rénaux chez les descendants et les ascendants pour réaliser une arbre généalogique.
5.2.2 L’arbre généalogique
Il est indispensable. Il existe 5 à 10% de mutation de novo. Dans 90% des cas de PKD, il existe une histoire familiale. Il est indispensable de réaliser une échographie rénale à la recherche d’une maladie kystique rénale.
5.3 Le diagnostic de certitude de la PKD
Le seul examen assurant un diagnostic de certitude est l’identification d’une mutation dans le gène PKD1 ou PKD2. La recherche de ces mutations est difficile. L’interprétation des mutations identifiées est parfois complexe. Une imagerie rénale performante et une histoire familiale sont dans habituellement suffisantes pour porter le diagnostic. Le diagnostic moléculaire s’il n’est pas indiqué du fait de la complexité de sa réalisation, peut permettre dans des cas difficiles de redresser le diagnostic. La différence de pronostic des formes liées à PKD1 ou PKD2 peut rendre légitime le génotypage par analyse de liaison ou recherche directe de la mutation.
6 Conclusion
La polykystose rénale autosomique dominante est une maladie génétique rénale fréquente. Son diagnostic est important car il est indispensable de dépister certaines complications qui peuvent engager le pronostic vital et rénal. Le diagnostic repose sur une analyse pertinente et attentive de l’arbre généalogique et de l’imagerie rénale. Chez un insuffisant rénal chronique ce ne doit pas être un diagnostic par défaut devant la présence de quelques kystes.
Points forts
1) La polykystose rénale autosomique dominante est une maladie rénale génétique fréquente qui est responsable de 8% des cas d’IRCT en France. Le diagnostic repose sur la présence de multiples kystes rénaux et un enquête familiale en faveur d’un mode de transmission autosomique dominant.
2) La polykystose rénale autosomique dominante est une maladie systémique qui peut se compliquer d’HTA précoce et d’anévrysmes des artères cérébrales. Ces complications sont dépistables et doivent bénéficier d’une sanction thérapeutiques.
3) La présence de kystes rénaux n’est pas synonyme de polykystose rénale autosomique dominante. Il existe d’autres maladies kystiques rénales. Le volume rénal est un élément important qui est une aide au diagnostic et un marqueur pronostic.
Dans les cas difficiles un avis spécialisé est indispensable.